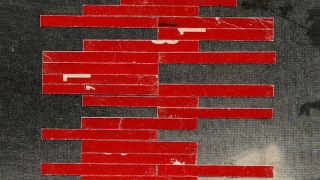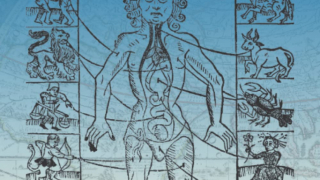L’hégémonie américaine – Du libéralisme au nihilisme
Alors que le regard des Occidentaux est rivé sur l’ennemi russe désigné par l’oligarchie de l’Ouest, les peuples européens ne voient pas le danger mortel que représentent les États-Unis qui sont en train de dépecer l’Europe. Phase finale d’une guerre économique menée par l’hêgemôn d’Outre-Atlantique contre le Vieux Continent. Pourquoi et comment « l’hyper-puissance » étasunienne en est arrivée à s’attaquer à ses propres vassaux européens qu’elle a intégrés à son grand espace ? Est-ce le propre des empires finissant que de piller et d’écraser leurs vassaux, ou bien ce comportement traduit-il une forme spécifique de puissance de géopolitique ?

L’Amérique n’est pas un empire
Tout État exerçant son pouvoir, son commandement, son imperium sur un territoire, peut être qualifié de tellurocratie. Et ce pouvoir terrestre est par nature limité, par des frontières naturelles ou artificielles.
Si tout État est terrestre, son espace de domination peut également être maritime. Il faut donc distinguer entre deux types de puissances géopolitiques : l’empire, dont le système de domination est terrestre, et qui s’étend sur terre, et la thalassocratie, la puissance maritime.
L’étymologie du mot empire, imperium, signifie en latin « commandement ». Un commandement qui s’exerce sur un territoire. Le territoire de l’empire s’étend en intégrant d’autres peuples, États ou royaumes, à son système de domination. L’empire, tel que nous l’entendons, est une puissance terrestre, suffisamment « égalitaire » pour assimiler les peuples conquis à une entité politique unique, centralisée ou du moins fédérale. L’archétype de l’empire est Rome.
Le mot grec hêgemôn, renvoie quant à lui à une nation, une puissance, qui exerce un commandement, une domination souveraine sur d’autres nations et peuples sans pour autant les assimiler. L’hêgemôn maintient une distinction nette entre le peuple dominant et les peuples dominés. Si l’hêgemôn est le plus souvent exercé par la thalassocratie, il est aussi propre à certaines tellurocraties, inégalitaires, qui ne peuvent, pour cette raison même, parvenir à l’échelle et au statut d’empire durablement. L’archétype de l’hêgemôn est Athènes.
Les deux types de puissances géopolitiques, impériale et hégémonique, de Rome et d’Athènes, se fondent sur des valeurs anthropologiques différentes ; d’un côté, en Grèce, des cités endogames, qui répugnent à se mélanger entre elles, et avec les non-Grecs, et de l’autre, Rome, un système égalitaire intégrateur des autres populations de la péninsule italienne et des peuples conquis au-delà.
L’expansion impériale était rendue impossible par la culture et l’anthropologie athéniennes, contrairement à la cité de Rome, égalitaire et autoritaire, à l’image du père romain qui avait tous les droits sur ses enfants, qui s’est étendue par les armes, mais aussi et surtout par l’assimilation graduelle des peuples italiens, puis méditerranéens.
La romanité, universaliste, embrassa presque tous les peuples conquis. Une puissance politique qui se fonde sur la filiation, le principe généalogique, la distinction entre les hommes, est condamnée à la division, à la réduction autour de son noyau ethnique, à moins qu’elle ne parvienne à soumettre les populations conquises et leur fasse admettre durablement le statut de paria et d’esclave. Un tel système tellurocratique ne saurait se maintenir en tant qu’empire des siècles durant. Un minimum d’intégration des populations conquises est nécessaire.
C’est d’ailleurs ce que l’on constate en se penchant sur l’histoire grecque. L’hellénisme, qui avait connu une période de prospérité et d’épanouissement entre le VIIe siècle et le Ve siècle avant Jésus-Christ, entra en décadence au IVe siècle av. J.-C., notamment en raison de l’incapacité des cités à s’unifier. D’ailleurs, la phase d’épanouissement n’empêcha pas les guerres incessantes entre Grecs et entre Grecs et étrangers colonisés. Une des causes du déclin de l’hellénisme en Italie fut les luttes entre cités grecques.
Toutes ces divisions étaient les conséquences d’une cause première : le différentialisme grec. L’obsession de la différence, même si elle n’existe pas, est le ferment de la division qui rend impossible l’établissement d’un authentique et durable empire.
Les États-Unis ont été fondés sur une base ethnique, exclusiviste, exceptionnaliste et génocidaire. Les Anglais qui ont débarqué en Amérique n’ont pas cherché à intégrer les autochtones comme l’auraient fait les Romains. Ils les ont exterminés et ont parqué la poignée restante dans des réserves.
Les relations internationales des États-Unis sont dans le même esprit, ils mènent une géopolitique ségrégationniste depuis qu’ils sont sortis de l’isolationnisme pour renouer avec l’héritage thalassocratique anglais. L’on ne peut donc pas qualifier les États-Unis d’empire. Ils sont un hêgemôn au sens athénien. L’hégémonisme étasunien est aggravé par l’exceptionnalisme religieux vétérotestamentaire des élites américaines qui se considèrent comme un peuple choisi, une nation Messie.
Les États-Unis : un hêgemôn vétérotestamentaire contre l’Europe
Il faut distinguer l’Europe continentale et le monde thalassocratique anglo-américain qui l’a conquise. L’on assimile aujourd’hui l’Occident et l’Europe car les États-Unis ont intégré à leur grand espace l’Europe latine et germanique.
Ce que l’on appelle aujourd’hui « l’Occident » est une construction idéologique et politique. La soumission de l’Europe à Washington s’est concrétisée par la création de structures supranationales, à savoir l’Union européenne et son pendant militaire, l’OTAN, le bras armé des États-Unis.
L’Occident est l’autre nom de l’intégration de l’espace européen au système de domination idéologico-politique anglo-américain judéo-protestant. La réforme religieuse et l’adoption du calvinisme par l’Angleterre au XVIe siècle ont accompagné une expansion économique et géopolitique de nature messianique qui a fini par détruire les barrières politico-juridiques de l’Europe fondées par Rome et son prolongement catholique.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui ont pris le relais de la Grande-Bretagne en tant que puissance dominante mondiale imposant son « ordre » tyrannique, l’expansion d’un désordre économique, politique, social, sociétale, et du chaos.
L’hégémonisme anglo-américain est le produit du messianisme vétérotestamentaire ; fusion du messianisme juif et du calvinisme. Ce qui explique notamment le puissant soutient britannique et américain à la fondation du Foyer national juif, à la création de l’État d’Israël et à la politique menée par l’État hébreu. Le projet sioniste étant une des branches du messianisme juif qui cherche à réaliser les promesses bibliques chères à Olivier Cromwell (1599-1658) et aux évangéliques américains qui prétendent les accomplir aujourd’hui1.
Dans les années 1530, l’Angleterre amorce une réforme religieuse qui suit de près la réforme luthérienne : fermeture des monastères, confiscation des biens de l’Église et rupture avec Rome. C’est Thomas Cromwell (oncle d’un ancêtre d’Olivier Cromwell), ministre principal du roi Henri VIII, qui mène cette politique. En 1534, la séparation entre l’Angleterre et l’Église catholique est consommée. L’Angleterre largue les amarres durant une réforme religieuse qui la mène à adopter le calvinisme. Thomas Cromwell déclare alors que « ce royaume d’Angleterre est un empire »2. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous le règne d’Elisabeth Ire (de 1558 à 1603), l’influence du judaïsme grandit en Angleterre en même temps que s’impose le puritanisme, courant du calvinisme qui visait à « purifier » l’Angleterre du catholicisme. La fusion entre le messianisme juif et l’hêgemôn protestant maritime naissant s’opère et constituera la matrice des États-Unis.
Le judaïsme jouera un rôle majeur dans l’Angleterre moderne et dans son orientation politico-religieuse. «On croyait autrefois qu’entre l’expulsion des Juifs sous Édouard Ier (1290) et le retour (plus ou moins officiel) à la liberté d’immigration sous Cromwell (1654-1656) il n’y avait pas de Juifs en Angleterre. Cette manière de voir n’est plus partagée aujourd’hui par aucun de ceux qui sont au courant de l’histoire des Juifs d’Angleterre. De tout temps il y a eu des Juifs dans ce pays, mais ils sont devenus très nombreux au cours du XVIe siècle. [La reine] Élisabeth elle-même avait une certaine préférence pour les études hébraïques et pour un entourage juif. Elle avait pour médecin Rodrigo Lopez, le Juif qui a fourni à Shakespeare le modèle de son Shylock.»3
Les rapports entre le protestantisme et le judaïsme, tout particulièrement le calvinisme, était particulièrement serrés. Il y avait chez les calvinistes anglais un «engouement pour la langue hébraïque et les études judaïques ; on sait plus particulièrement que, dans l’Angleterre du XVIIe siècle, les Puritains entouraient les Juifs d’un culte presque fanatique… Un prédicateur puritain, Nathanaël Holmes (Homesius) déclarait que son désir le plus ardent était de se conformer à la lettre de certains versets des Prophètes et de servir Israël à genoux. La vie publique et les sermons d’Église présentaient un cachet israélite. Il ne manquait plus, pour qu’on se crût tout à fait transplanté en Palestine, que les orateurs parlementaires se missent à parler hébreu. Les ‘‘Levellers’’ (‘‘Nivelleurs’’), qui se qualifiaient eux-mêmes de ‘‘Juifs’’, exigeaient la promulgation d’une loi faisant de la Torah un code anglais ; les officiers de Cromwell lui proposèrent de composer son Conseil d’État de soixante-dix membres, à l’exemple du Synhedrim [Sanhédrin] juifs ; parmi les membres du Parlement de 1653 se trouve le général Thomas Harrison, un anabaptiste, qui, d’accord avec son parti préconisait l’introduction de la loi mosaïque en Angleterre ; en 1649, il a été proposé au Parlement de remplacer le jour férié du dimanche par le samedi; les bannières des Puritains victorieux portaient l’inscription : ‘‘The Lion of Judah.’’4
Mais il est également établi que le clergé et les laïcs chrétiens de cette époque lisaient non seulement l’Ancien Testament, mais aussi la littérature rabbinique. Il est donc tout à fait naturel d’admettre que les doctrines puritaines proviennent directement des doctrines juives. »5
L’influence se fit sentir aussi dans le domaine économique. Une osmose s’opéra entre le calvinisme et l’hêgemôn commerçant anglais.
« Calvin et les calvinistes abordèrent l’économie comme des hommes d’affaire ». Ils adressèrent leur enseignement principalement à la bourgeoisie commerçante et industrielle. Le capital, le crédit, la banque et le grand commerce étaient reconnus presque comme des articles de foi. Le calvinisme est en grande part un mouvement urbain, et « fut transporté de pays en pays par des commerçants et des ouvriers émigrants… »
Le calvinisme a son quartier général à Genève, et plus tard, ses adeptes les plus influents dans les grands centres d’affaire, comme Amsterdam et Londres.
« Ses chefs adressèrent leur enseignement, non pas exclusivement, mais principalement aux classes engagées dans le commerce et l’industrie, qui formaient les éléments les plus modernes et progressistes de la vie du siècle.
Ce faisant, ils commencèrent, de toute évidence, par reconnaître franchement la nécessité du capital, du crédit et de la banque, du grand commerce et de la finance et des autres données pratiques du monde des affaires. Ainsi rompent-ils avec la tradition qui, tenant pour répréhensible tout souci des intérêts économiques ‘‘au-delà de ce qui est nécessaire pour la subsistance’’, avait stigmatisé l’intermédiaire comme un parasite, et l’usurier comme un voleur. 6
Le calvinisme était une doctrine religieuse bourgeoise, taillée pour le commerçant et le banquier. Calvin enseigna à cette bourgeoisie « à se sentir comme un peuple élu, la rendit consciente de sa grande destinée à accomplir selon le dessein de la Providence, et résolues à l’accomplir. »7
La prédestination était un équivalent de l’élection divine du judaïsme. Elle prit une forme socio-économique et hégémonique en fusionnant avec l’anthropologie anglaise (famille nucléaire, inégalitaire, avec une mobilité spatiale des individus très importante)8 au moment de la transformation de l’île en hêgemôn maritime.
Evidemment, toute cette structure politico-religieuse a un lien direct avec la politique internationale menée depuis des siècles par les Anglais et les Américains. Car, il y a une « complicité géopolitique entre le calvinisme institué et le sursaut des énergies maritimes de l’Europe. Même les fronts religieux et les slogans théologiques de cette époque portent en eux l’antagonisme des forces élémentaires qui ont provoqué ce glissement de l’existence historique du continent à la mer. »9
Cette révolution, ce passage de la terre à la mer, cette transformation en hêgemôn mondial, se font à partir du XVIe siècle, le siècle de la réforme protestante et de l’adoption, par l’Angleterre, du calvinisme.
« Le fait que la mer soit une tend à rendre hégémonique la maîtrise des mers, de même que le commerce maritime tend au monopole. »10, écrivait le géographe allemand Friedrich Ratzel à la fin du XIXe siècle.
C’est en substance ce que disait l’écrivain, officier et explorateur anglais Walter Raleigh (1552-1618) qui a vécu l’époque de la transformation de l’Angleterre en hêgemôn des mers : « Qui domine la mer domine le commerce mondial ; qui domine le commerce mondial possède tous les trésors du monde – et le monde tout court. »11
La mer, sans frontière, est un monde de l’indistinction. C’est un espace liquide, mobile, instable, tantôt calme, tantôt agitée. Il est en cela diamétralement opposé au monde de la terre, au continent européen, celui de la frontière naturelle ou artificielle, de la limite, de la distinction, de la stabilité, de l’ordre et donc du droit.
Les puissances judéo-protestantes, l’Angleterre et les États-Unis, sont les vecteurs de la globalisation économique, de la consommation individualiste et jouisseuse, de la société de l’indistinction, sans frontière ni attache, du capitalisme libéral financier sauvage, étendu par le système de libre-échange. Tout ce qu’ils ont imposé au monde. De tout cela, le judéo-protestantisme a été le moteur, sans oublier l’anthropologie et la culture anglaises qui étaient le terreau favorable à l’implantation du calvinisme et au passage vers la mer.
L’État qui tente de freiner l’expansion de cet hêgemôn liquide qui envahit chaque millimètre de la société, est considéré comme un ennemi, un frein à l’unification du monde, à l’instauration d’un nouvel Eden terrestre. Ce que nous percevons comme une tyrannie unipolaire est, du point de vue judéo-protestant anglo-américain, la marche vers la paix universelle, le millenium que tente d’instaurer les États-Unis, pour le « bien » de l’humanité.
De l’hégémonie libérale au nihilisme
C’est à la fin du XIXe siècle que les États-Unis commencent à rompre avec leur traditionnel isolationnisme, et renouent avec l’héritage britannique, l’héritage de l’hêgemôn mondial océanique. L’Amérique fait alors retour à son arkhè, sa nature anglaise.
« L’Europe centrale par exemple commit une grave erreur de n’avoir pas compris le passage des États-Unis, entre 1892 et 1898, de la situation d’un État continental largement autarcique à celle d’une puissance industrielle et commerciale océanique et agressive, comme le fit par exemple l’Angleterre, qui grâce au géopoliticien Lord Bryce conclut à temps, au prix de grands sacrifices, sa paix culturo-politique avec le grand État qui était sa fille et trouva ainsi son aide dans la guerre mondiale. »12, écrit Karl Haushofer (1869-1946).
L’Europe sera, à partir du début du XXe siècle, face à une puissance colossale, une océanocratie que l’on peut également qualifier d’hêgemôn offshore, hors-sol. Cet hêgemôn est hors sol, car les zones qu’il domine ne sont pas dans le prolongement terrestre de son propre État. Il s’impose par voie maritime. L’Angleterre, comme les États-Unis, sont séparés par la mer des pays qu’ils dominent, et c’est par la mer qu’ils les attaquent et les menacent.
Sur le plan économique, l’hêgemôn étasunien s’est imposé au monde en découplant, dans l’espace, l’État et l’économie. Ce processus correspondait à la mentalité et à la culture juridique anglaise qui ne connaissait pas le dualisme entre droit privé et droit public propre aux États continentaux. Ainsi, le droit international du libre commerce et de la libre économie se combina au XIXe siècle et brisa l’entrave continentale. C’est-à-dire que l’Angleterre « pouvait entrer immédiatement en contact direct avec la composante privée, libre d’État, que comportait tout État européen. »13
L’Angleterre ouvrit ainsi la voie économico-juridique aux États-Unis. En découplant l’État et l’espace économique, les Britanniques, et les États-Unis à leur suite, cherchaient à établir une hégémonie universelle, par définition sans frontière. Mais pour diriger ce monde aux délimitations abolies, il faut un centre de décision politique, donc un État. Par conséquent, les États-Unis vont chercher à affaiblir tous les États du monde, à commencer par ceux d’Europe, tout en étendant leur armée qui dépend, elle, d’un État, d’un centre de décision, à Washington.
Et cette orientation était perceptible dans la politique des États-Unis à l’époque du président Woodrow Wilson (1913-1921). Ce dernier, qui était le maître de la Société des Nations (précurseur de l’ONU), s’était assuré une influence sur l’Europe et l’impossibilité pour celle-ci d’intervenir – via la Société des Nations – dans les affaires de l’Amérique, au nom de la Doctrine Monroe. Les États-Unis étaient absents de la Société des Nations, mais 18 États d’Amérique, sous domination étasunienne, y étaient présents.
Cette méthode stratégique demeurera celle des États-Unis jusqu’à nos jours avec une accentuation à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la création des institutions internationales et globalistes (le GATT devenu l’OMC, le FMI, la Banque mondiale, l’OMS). Cette absence apparente des États-Unis, qui utilisent des organisations supra-nationales, est d’une grande utilité en ce qu’elle rend invisible, aux yeux des peuples « colonisés », la domination de l’hêgemôn.
La gouvernance mondiale anglo-américaine a ainsi pour corolaire et moyen l’établissement à l’échelle planétaire des règles de libre-échange et l’abolition de l’État souverain qui constitue une entrave à cette domination. Les accords de Bretton Woods de 1944, qui devaient répondre à la crise de 1929 et aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale, en refondant le système financier et monétaire international, ont donné naissance à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international.
Ce qui sortit de ces accords était conforme à la volonté des États-Unis, à savoir, faire du dollar l’instrument des échanges internationaux et imposer la libéralisation des mouvements de capitaux.
Les règles du commerce international furent traitées durant la conférence de la Havane la même année. Les Américains, partisans du libre-échange, avaient refusé de signer l’accord visant à réglementer le commerce sur des bases nationales et protectionnistes.
L’Organisation mondiale du commerce, qui succéda au GATT (fondé en 1947) en 1995, se chargera de répondre aux désirs des États-Unis en favorisant le système de libre-échange généralisé.
En 1982, un rapport du Trésor américain mettait en lumière la domination qu’exerçait les États-Unis sur la Banque mondiale : « Les États-Unis ont largement participé à l’architecture et à la définition de la mission de la Banque mondiale selon les principes occidentaux de libre-marché… Nous sommes aussi responsables de l’apparition d’une organisation fonctionnant au scrutin proportionnel, supervisée par un conseil d’administration, gérée par un management de haut niveau dominé par des Américains et par du personnel administratif très qualifié. En tant que membre fondateur et principal actionnaire de la Banque mondiale, les États-Unis ont droit à l’unique siège permanent au conseil d’administration de la Banque. »14
Comme l’a souligné le politologue philippin Walden Bello, « la Banque mondiale a été un instrument important de la politique globale américaine, car elle a réussi, avec les banques de développement multilatéral, à remplir la tâche difficile d’exiger des emprunteurs de satisfaire des critères de performance standard, une tâche que les États-Unis et les autres prêteurs répugneraient à imposer dans un cadre bilatéral. »15
Et l’ancien sous-secrétaire au Trésor étatsunien, Peter McPherson, l’a admis : « Nous n’avons pas obtenu beaucoup de succès par nous-mêmes, en essayant de mettre en place une politique de réformes aux Philippines. C’est une question neutre, en quelque sorte. Mais la Banque mondiale, elle, a remarquablement réussi à négocier d’importants changements politiques, que nous soutenons vigoureusement. »16
La financiarisation de l’économie a été imposée en Occident par les tenants judéo-américains de la Haute Finance.
« Lors des opérations de renflouement financier du Mexique en 1994-1995 et des pays d’Asie du Sud-Est en 1997, le directeur exécutif du FMI, Michel Camdessus, était largement considéré comme un pion du secrétaire au Trésor Robert Rubin et de son proche assistant Lawrence Summers, poussant le New York Times à parler du Fonds comme d’un ‘‘proxy des Etats-Unis17’’ »18
Robert Rubin (qui a poussé à l’adoption du Gramm-Leach-Bliley Financial Service Modernization Act de 1999, liant de nouveau les banques d’affaires et de dépôt), vient de la banque judéo-américaine Goldman Sachs et il a été, de 2007 à 2017, co-président émérite du très influent think tank CFR (Council on Foreign Relations).
Le libre-échangisme et la financiarisation ont fini par miner l’industrie et l’économie même des États-Unis qui sont depuis lors en déclin. L’hyper-puissance étasunienne coïncidait avec une puissance économique fondée sur une puissance industrielle qui étaient, de loin, la première au monde. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l’économie des États-Unis représente 33% du PNB (produit national brut) mondial. Mais à partir des années 1970 le déclin économique des États-Unis s’amorce.
Les forces globalistes qui logent aux États-Unis et qui utilisent son appareil militaire pour soumettre et unifier le monde, sont porteurs d’un modèle économique fictif et d’un projet sociétal nihiliste qui détruit l’Amérique, censée incarnée et proposer au monde ce modèle de société que la majorité des pays du monde rejette.
Au lieu de l’unification de la planète par un marché universel et une société unique LGBTiste, de grands espaces politico-économiques rivaux sont apparus. C’est-à-dire, non pas des États fédéraux comme l’imaginait Maurice Hauriou (1856-1929), mais la mise en place, par des États souverains, d’accords économiques et commerciaux, avec des systèmes de transactions éliminant le dollar et rejetant les valeurs progressistes de l’Occident décadent.
Le néolibéralisme économique et le progressisme sociétal consument les sociétés occidentales déchristianisées. À ce stade, nous ne pouvons plus parler d’idéologies structurantes mais de politiques économiques, sociales et sociétales nihilistes. Le nihilisme a également atteint le domaine du droit. Ce qui se traduit, notamment, par un état d’exception permanent, lequel a été répandu à l’échelle occidental par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
Cet état d’exception a permis l’émergence d’un totalitarisme à l’échelle occidental et une série de guerres atlantistes à l’échelle de « l’Île Monde » (Europe, Asie, Afrique). Mais cette guerre n’est pas exclusivement militaire, ce n’est pas qu’une guerre civile mondiale, c’est un pan-polemos. Une guerre interétatique, intra-étatique, socio-économique, biologique, religieuse, existentielle. C’est une guerre contre la vie, une guerre contre la création, une guerre contre la Loi naturelle que mène l’oligarchie occidentale.
Mais le paradoxe de ce globalisme nihiliste et totalitaire, c’est qu’il a toujours besoin, en Occident, d’appareils d’État pour tenir en rang et réprimer les populations. Des États européens totalitaires mais faibles. En effet, ce qui reste de l’État, dépouillé de ses prérogatives régaliennes par l’Union européenne et l’OTAN, c’est la police, le ministère de l’Intérieur, la capacité de répression, non pas des délinquants, mais de la classe moyenne élargie, ennemie principale du pouvoir oligarchique. C’est ainsi que l’État est devenu l’agent du désordre.
La seule solution est la restauration de l’État et la récupération de sa souveraineté politique. Malheureusement, le pouvoir oligarchique qui occupe la tête et les organes de l’État a fermé toutes les issues pacifiques. Il a choisi celle de la violence, de la guerre contre toutes les catégories productives de la société.
« Les conséquences de la partialité en faveur des grands sont celles-ci : l’impunité produit l’insolence, l’insolence produit la haine, et la haine est la source d’efforts pour abattre toute grandeur oppressive et insolente, même si cela doit entraîner la ruine de la République. » (Thomas Hobbes, Le Léviathan)
Une ruine qui nécessitera la constitution d’un pouvoir de refondation du droit et de l’État.
1 Youssef Hindi, Occident et Islam – Tome 1 : Sources et genèse messianiques du sionisme, Sigest, 2015.
2 G. R. Elton, The Tudor Constitution : Second Edition, Cambridge University Press, 1982, p. 353.
3 Werner Sombart, Les Juifs et la vie économique, traduit de l’allemand au français par le Dr S. Jankélévitch, 1923, rééd. Kontre Kulture, 2012, pp. 52-53.
4 Heinrich Graetz, Geschichte der Juden, IX, p. 86 et sv., p. 213 et sv. ; X, p. 87 et sv. ; Alb. M. Hyamson, History of the Jews in England, 1908, p. 164 et sv. ; Jewish Quarterly Review, VIII, 1891, p. 61.
5 Werner Sombart, op. cit. pp. 438-439.
6 R. H. Tawney, La religion et l’essor du capitalisme, Londres, 1926, Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1951, p. 103.
7 R. H. Tawney, La religion et l’essor du capitalisme, p. 110.
8Sur le rapport entre l’anthropologie anglaise et l’économie libérale, voir : Alan MacFarlane, « The Origins of English Individualism : Some Surprises », Theory and Society, Volume 6, Issue 2 (Sept. 1978), pp. 255-277.
9Carl Schmitt, Terre et mer, 1942, Le Labyrinthe, 1985, Pierre-Guillaume de Roux, 2017, Krisis, 2022,. pp. 171-172.
10Friedrich Ratzel, La géographie politique, 1897, Fayard, Paris, 1987, p. 174.
11Cité par Carl Schmitt, Terre et mer, 1950, Presses Universitaires de France, 2001,p. 173.
12Karl Haushofer, De la géopolitique, 1986, Fayard, p. 109.
13Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, p. 212.
14US Treasury Department, Assessment of US participation in the Multilateral Development Banks in the 1980s, Washington, DC, US Treasury Department, 1982, ch. 3, p. 1.
15Congressional Research Service, The United States and the Multilateral Development Banks, Washington, DC, US Government Printing Office,1974, p. 5. Cité par Walden Bello, La démondialisation, 2002, éd. Le Serpent à Plume, 2011, pp. 150-151.
16 Cité dans Walden Bello, The role of the World Bank in US Foreign Policy, Covert Action Information Quartely, N° 5, automne 1990, p.22.
17 Cité dans « 20 Questions on the IMF », dans Multinational Monitor, avril 2000, p. 23.
18Walden Bello, La Démondialisation, pp. 154-155.
Source : https://strategika.fr